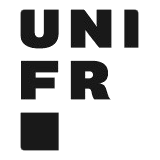Peinture et récit
Dans le De pictura (1435), Leon Battista Alberti ajointe peinture et histoire. Le grand œuvre du peintre, selon lui, n’est pas la production d’un colosse mais la représentation d’une historia. Cette assertion décisive du texte fondateur de la théorie moderne de la peinture ne signifie pas que le peintre doit nécessairement représenter un événement historique – même s’il peut le faire, bien sûr –, mais qu’il doit penser la composition picturale dans son rapport au récit. À partir de ce geste inaugural, l’horizon narratif de la peinture va progressivement s’imposer aux artistes, à tel point qu’au XVIIe siècle, lorsqu’une hiérarchie des genres picturaux sera instituée (Félibien, 1667), c’est la peinture d’histoire qui trônera au sommet de l’édifice. « Lisez l’histoire avec le tableau » écrivait Nicolas Poussin à son ami Chantelou en 1639 pour le guider dans l’appréciation de La Manne.
Il y aurait donc une possibilité de rapprocher écriture et peinture, lisible et visible, de les faire tenir ensemble. Mais quels sont les modalités de ce mariage ? Par quelles voies le peintre se fait-il narrateur ? Et jusqu’à quel point peut-il rivaliser avec le poète, le dramaturge ? Lessing au XVIIIe siècle opposera la peinture, en tant qu’art de l’espace, à la poésie, comme art du temps. Est-ce à dire que les peintres ont trahi le propre de la peinture en se faisant conteurs ? Alberti se serait-il trompé ? Pour y répondre, il importera de comprendre la variété des formes de récit inventées par les artistes, dans leur relation aux questions politiques, sociales, poétiques, religieuses, philosophiques qui les traversent.
- Docente: Kalinka Janowski
- Docente: Jérémie Koering
- Docente: Violette Marbacher