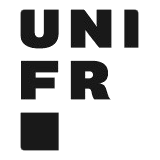Présenté dans un musée, un tableau n’offre, le plus souvent, que son avers à la contemplation. Et pour cause, la peinture est traditionnellement assimilée à la conquête par la couleur d’une surface plane destinée à être accrochée à ou posée contre un mur. Cette vision de la peinture de chevalet, dont Clement Greenberg a offert une définition canonique, s’est imposée à nous. Mais elle dissimule en vérité une réalité plus complexe. Un tableau, tout en ayant généralement une face principale, a aussi un revers. Revers qui peut, en certaines circonstances et en vertu de certaines manipulations, tout aussi bien disputer sa place à l’avers (en particulier lorsqu’il s’agit d’œuvres à double-face).
Depuis quelques années, l’anthropologie historique et le material turn qui animent les sciences humaines ont heureusement transformé notre compréhension des objets artéfactuels en attirant l’attention sur des données matérielles jusqu’ici négligées ou confinées aux seules problématiques de conservation. Matériaux employés, manières de faire, conditions de déplacements, restaurations, altérations et transformations en tous genres sont autant d’informations récoltées pour mieux comprendre la vie et les usages des œuvres.
Cette attention portée aux données matérielles a notamment poussé conservateur·rice·s et historien·ne·s de l’art à s’intéresser à ce qui échappe à la visibilité et à entreprendre des études plus systématiques des revers. Or, en sa face cachée, un tableau ne dévoile pas uniquement l’aspect du subjectile (toile, bois, pierre, métal) sur lequel surgit l’œuvre de peinture. En cette autre face, on trouve aussi, seules ou combinées, quantité de choses à voir et à penser : peintures, dessins, inscriptions, marques d’atelier, signes de dévotion, numéros d’inventaire, étiquettes de transports, etc.
En étudiant la spécificité de ces traces et la façon dont elles ont été traitées par les spécialistes – qu’il s’agisse de connaisseur·sseuse·s, d’iconologues, d’anthropologues des images, d’historien·ne·s des collections et des expositions ou de chercheur·cheuse·s en provenance –, ce cours thématique entend non seulement réfléchir à ce que notre connaissance du revers nous apprend sur le tableau dans sa totalité, mais encore sur les différentes manières de faire de l’histoire de l’art.
- Enseignant·e: Kalinka Janowski
- Enseignant·e: Jérémie Koering
- Enseignant·e: Violette Marbacher