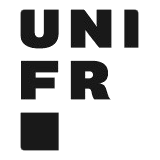|
« L’allégorie enseigne ce que tu dois croire et l’anagogie vers quoi tu dois tendre » (Nicolas de Lyre, Postilla in Gal. 4, 3)
Ce cours examine les liens profonds entre art et dévotion en Europe aux XVe et XVIe siècles, période marquée par un renouveau des pratiques religieuses et des formes artistiques. Retables monumentaux, fresques conventuelles, statues processionnelles, manuscrits enluminés, tableaux de dévotion privée et gravures façonnent la vie religieuse, accompagnent la prière, orientent la méditation et ouvrent à la contemplation. L’art visuel agit comme médiation entre le fidèle et le sacré, traduisant la foi dans des formes sensibles et intelligibles. Au cœur de ce langage, l’allégorie occupe une place centrale : elle enseigne, guide le regard et l’esprit, transforme la contemplation en expérience et relie le visible à l’invisible. Comme le souligne Nicolas de Lyre, allégorie et anagogie se présentent comme des clés intellectuelles pour appréhender les Écritures. Même lors des bouleversements religieux de la Réforme, les iconographies allégoriques deviennent des instruments pour orienter la croyance et la pratique, soulignant la capacité de l’image à transmettre, soutenir et former la foi. Face aux contestations de la Réforme et aux exigences de la Contre-Réforme, l’art dépasse la simple représentation de la foi. Menacé de destruction ou célébré avec ferveur, il met la dévotion en œuvre, transformant l’image en action spirituelle capable d’engager le fidèle et d’élever la contemplation vers le salut. |
- Enseignant·e: Fiammetta Campagnoli
- Enseignant·e: Kalinka Janowski
- Enseignant·e: Jérémie Koering
- Enseignant·e: Violette Marbacher