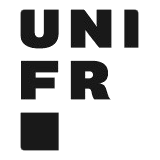|
Pendant des siècles, Jérusalem et la Palestine ont été perçues, par les adeptes des trois traditions religieuses dites « abrahamiques » (judaïsme, christianisme et islam), comme le véritable centre du monde en raison de leur « sainteté ». Celle-ci était définie et vécue tant par les communautés locales — très diverses sur les plans linguistique et religieux — que par les innombrables pèlerins venus du monde entier, selon des modalités variées, mais partageant l’idée que la région était constellée de lieux, c’est-à-dire de portions de sol, bénis par le passage de personnages sacrés, et renvoyant à des personnes et événements passés ou futurs dignes d’être commémorés et vénérés.
Le cours, fondé sur les recherches menées par le professeur Bacci et son équipe dans le cadre du projet SNSF-Advanced Grant « Holy Networks », examine les dynamiques par lesquelles les « lieux saints » ont été investis d’associations avec les différentes histoires sacrées juives, chrétiennes et musulmanes, ainsi que les multiples façons dont leur expérience physique a été orientée par l’encadrement architectural, la mise en scène de leurs points focaux, le déploiement de décorations et d’images, la promotion de pratiques performatives et l’organisation de parcours cinétiques prédéfinis.
Outre un parcours historique des lieux saints de l’Antiquité tardive à la période ottomane, c’est-à-dire jusqu’aux seuils de la modernité, le cours adopte une approche comparative visant à souligner à la fois les convergences et les divergences dans l’expérience de la sainteté localisée en Palestine par les juifs, les chrétiens et les musulmans. Une attention particulière sera portée aux lieux fréquentés et partagés par plusieurs communautés, dans le but d’offrir également une clé de lecture pour le présent.
Le cours bénéficiera également de la participation d’experts invités qui approfondiront certains thèmes sous différents angles
|