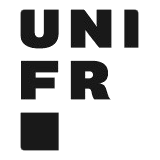En un sens, l’ambition d’améliorer l’humanité et d’en faire croître les vertus a toujours fait partie du projet de l’éthique philosophique. Pourtant, depuis les deux dernières décennies, c’est une tout autre conception de l’humain augmenté qui occupe le devant de la scène. À l’ère des "Human Enhancement Technologies", des implants cérébraux, aux lunettes de Google en passant par l’ingénierie génétique, la transformation de l’homme est un champ d’interventions techniques sur le corps ou l’esprit, qui vise une augmentation du pouvoir de l’humain sur lui-même, sur le monde et sur les autres.
Or, cette amplification technique sans précédent des capacités humaines engage un tout autre rapport à l’éthique : alors que cette dernière relevait dans l’Antiquité des "techniques de transformation de soi" (Michel Foucault), les sociétés contemporaines attendent désormais de l’éthique qu’elle aide à réguler les effets les moins souhaitables de ces nouvelles technologies, qu’elle partage leurs pouvoirs de façon égalitaire, et qu’elle les maintienne "sous contrôle" de l’humanité.
Ces évolutions suscitent deux séries de question. D’une part, qu’est-ce qui est véritablement nouveau dans ces techniques de transformation de l’humain d’un point de vue éthique ? Faut-il les voir comme le simple prolongement d’antiques aspirations (la sérénité, l’évitement de la souffrance et de la maladie, la mémoire, la sagacité, etc.) ou comme les acteurs d’un projet d’une toute autre nature ("transhumaniste, post-humaniste") ? D’autre part, l’éthique peut-elle assumer ce nouveau rôle régulateur ? Si oui, à quelles conditions ? Le cours vise à y répondre en resituant dans un premier temps la problématique éthique de l’humain augmenté dans le temps long des techniques de transformation de soi, et en abordant dans un second temps les enjeux normatifs liés à cette thématique contemporaine.
- Enseignant·e: Nicolas Blanc
- Enseignant·e: Jean-Gabriel Piguet