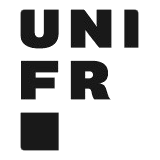Glossaire
Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
D |
|---|
DiversitéDe manière générale, le terme de « diversité » fait référence à la variété et la pluralité. Cependant, les références du terme varient selon les disciplines et les contextes. Diversité au sein du groupe des femmes / des hommes : De fait, les groupes des hommes et des femmes sont plus marqués par la diversité que par l’homogénéité. Vouloir repérer systématiquement des différences empiriques entre les hommes et les femmes quant à leurs qualités ou comportements pose un problème, car ce faisant, l’on présuppose ces deux catégories et l’on mesure les effets de la socialisation et des stéréotypes de genre. Il est reconnu que les différences au sein de chaque groupe sont plus grandes que la différence entre les moyennes de chaque groupe. Diversité résultant du lien entre le genre et d’autres dimensions : Au sein des études genre, il est aujourd’hui largement reconnu que la situation et les expériences des femmes et des hommes ne sont pas définies uniquement par la dimension de genre. L’approche intersectionnelle analyse les articulations entre la dimension de genre et d’autres dimensions d’inégalité sociale – notamment la classe sociale, la race (en tant que rapport social), l’origine culturelle ou l’orientation sexuelle – et mène une réflexion théorique à ce propos. Diversité résultant du décloisonnement des catégories de genre : La remise en cause de la binarité de la dimension de genre a débouché sur un décloisonnement des catégories de sexe et de genre. Les positions LGBTI manifestent la diversité des identités de genre et des orientations sexuelles dans la société. Diversité en pédagogie : Dans le contexte pédagogique, c'est plutôt le terme d'« hétérogénéité » qui est couramment utilisé. Il englobe tout l’éventail des différences parmi les élèves ou étudiant-e-s qui peuvent intervenir en situation d’enseignement/ d’apprentissage. Cela recouvre autant les différences linguistiques que les différences par rapport aux connaissances ou expériences préalables, autant les styles et rythmes d’apprentissage que les intérêts ou motivations différentes. Dans le cadre de l’enseignement supérieur, il s’agit donc de garder à l’esprit la diversité au sein du corps estudiantin. Bagage familial, motivations et intérêts d’une étudiante issue de milieu académique seront différents que ceux d’une étudiante ou d’un étudiant issu de milieu défavorisé. De même, bagage familial, motivations et intérêts d’un étudiant de milieu ouvrier suisse se distingueront de ceux d’une étudiante issue de l’immigration. En prenant en compte la diversité des étudiant-e-s dans votre enseignement, vous contribuez à réduire les stéréotypes de genre et à déconstruire une vision homogène des femmes et des hommes. Pour prendre en compte genre et diversité dans l'enseignement supérieur, cf. Eckmann & Földhazi (2013) ainsi que Czollek & Perko (2008). Au niveau institutionnel, la prise en compte de la diversité autant des étudiant-e-s que des collaborateurs et collaboratrices demande des stratégies de gestion de la diversité. | |
Doing genderComment les inégalités de genre se reproduisent-elles au quotidien ? Le concept du « Doing gender » s’avère être utile à cette réflexion, car il éclaire les processus (inconscients) de construction du genre dans les interactions et les pratiques quotidiennes. En effet, dans nos interactions quotidiennes, nous classons continuellement et sans y penser les personnes avec lesquelles nous sommes en contact soit dans la catégorie « hommes » soit dans la catégorie « femmes »; en même temps, nous affichons également notre propre catégorie en tant que femme ou en tant qu’homme ce qui, en règle générale, est perçu et validé par notre vis-à-vis. Pour réaliser à quel point ce mécanisme relève de l’évidence, il suffit de penser à l’embarras qui surgit dans une situation où la classification est ambiguë, par exemple si l’apparence d’une personne ne correspond pas à son registre de voix. | |
E |
|---|
Espaces éducatifs non-mixtesDans des disciplines fortement masculines, il peut être opportun de proposer ponctuellement des dispositifs d’apprentissage non-mixte, à l’école par exemple en physique. Cela permet aux garçons et aux filles d’expérimenter et de développer un éventail de comportements et d’intérêts plus large. Un tel dispositif permet notamment aux filles de développer des compétences et de l’assurance dans un domaine connoté comme étant masculin. | |
G |
|---|
GenreLe concept | |
I |
|---|
Interactions entre enseignant-e et étudiant-e-sParmi les facteurs qui peuvent expliquer des différences de motivation entre garçons et filles, Meece et al. (2006) discutent les schémas d’interaction entre enseigant-e et élèves en milieu scolaire. En général, les enseignant-e-s auraient tendance à apporter plus de soutien aux élèves envers qui leurs attentes sont élevées. Ces élèves auraient, de ce fait, plus souvent l’opportunité de montrer leur savoir et recevraient plus de retours encourageants. | |
Interactions entre enseignant-e et étudiant-e-s : ObservationLes questions suivantes peuvent vous aider à vous rendre compte de la manière dont vous gérez l’espace des interactions avec vos étudiant-e-s dans votre enseignement:
| |
IntersectionnalitéLe concept d’« intersectionnalité » prend en compte les différentes dimensions d’inégalité sociale dans leur articulation et leur interdépendance (cf. Walgenbach 2012). Sont pris en considération notamment la dimension de genre, la classe sociale, la race en tant que rapport social, l’origine culturelle, la sexualité, le handicap et d’autres. Le choix des dimensions pertinentes dépend de la situation spécifique et du contexte respectif. Dès leurs débuts, les études genre ont été préoccupées par la question de comment concevoir – au niveau théorique – l’articulation des rapports de genre avec d’autres rapports de pouvoir, notamment ceux de classe. Dans les années 1980, la critique de femmes noires, lesbiennes ou issues de l’immigration – pour ne mentionner que celles-ci – a attiré l’attention sur le fait que les théories et revendications féministes étaient développées à partir de la position de femmes blanches, hétérosexuelles, de classe moyenne et reflétaient leurs expériences sans prendre en compte l’expérience d’« autres » femmes. Une perspective intersectionnelle sur le système de formation révèle l’effet croisé de l’origine sociale, du genre et du pays d'origine sur les parcours de formation et l’accès à la formation supérieure. Une telle perspective peut également aider à mieux comprendre les situations concrètes d’enseignement et d’apprentissage. Un exemple : le rapport de genre qui sous-tend les interactions entre une enseignante de culture française et un étudiant de culture maghrébine sera modulé par l'origine culturelle respective des deux personnes. Ou encore : les étudiants d’origine européenne et issus de milieu académique prendront plus souvent la parole et auront plus de poids dans une discussion que des étudiant-e-s issu-e-s de milieux moins favorisés ou de culture extra-européenne. Enfin : si des étudiantes d'origine asiatique ne participent pas activement aux activités proposées, cela peu relever autant des méthodes d'apprentissage pratiquées dans le système éducatif de leur pays d'origine que de stéréotypes de genre.
| |
L |
|---|
Langage inclusif – anglaisPeut-être que vous dispensez également des enseignements en langue anglaise. La problématique d’un usage inclusif du langage se pose aussi en anglais. Même si les substantifs n’ont pas de genre grammatical, vous faites référence à une femme ou à un homme avec le pronom utilisé dans la phrase suivante. Un exemple : The director was invited to present the new project. She was accompanied by her assistant.
D’autre part, l’usage de « man » est souvent problématique. Voici des alternatives possibles :
Pour exprimer la diversité de genre (cf. LGBTI - identités « queer ») à travers le langage également, le pronom they s’est imposé en anglais comme troisième pronom au singulier à côté de he ou she :
Vous trouverez d’autres exemples et de plus amples informations sur le site des Nations Unies « Gender-inclusive language » : https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml | |
Langage inclusif – DéfinitionLe langage inclusif et un langage qui représente autant les femmes que les hommes et s’adresse ainsi bien aux unes qu'aux autres. Plus récemment, ce terme s'est imposé pour rendre compte de la diversité des identités de genre dans le langage également (cf. LGBTI - « identités queer »). On utilise également le terme de langage épicène. | |