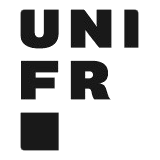Glossaire
Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
A |
|---|
Approche expliciteEn principe, vous avez deux possibilités pour développer une pratique de l’enseignement sensible au genre : l’approche implicite et l’approche explicite (cf. Dehler & Gilbert 2010).
| |
Approche impliciteEn principe, vous avez deux possibilités pour développer une pratique de l’enseignement sensible au genre : l’approche implicite et l’approche explicite (cf. Dehler & Gilbert 2010).
| |
Approches de l’apprentissageLe concept de l’approche de l’apprentissage renvoie à la manière dont les étudiant-e-s appréhendent une tâche d’apprentissage spécifique. Les approches suivantes de l’apprentissage sont largement reconnues par différent-e-s auteur-e-s et ont été validées empiriquement (cf. Wild 2010, Entwistle & Peterson 2004):
» Approches de l'apprentissage et genre » Approches de l'apprentissage et approches de l'enseignement » Bibliographie | |
Approches de l’apprentissage et approches de l’enseignementGrasha (1996), par exemple, distingue les préférences d’apprentissage des étudiant-e-s à l’aide de trois dimensions : attitude compétitive – collaborative, participante – évitante, dépendante – indépendante. Il en discute également les implications pour un enseignement adapté.
» Bibliographie | |||||||||||||||||||||||||||
C |
|---|
Compétences genrePour dispenser un enseignement supérieur sensible au genre, il est nécessaire que les enseignant-e-s développent des compétences genre. Voici une définition de ce terme : « les compétences genre comprennent les savoirs touchant aux rapports de genre et leur origine. Elles incluent aussi la capacité d’intégrer ces savoirs dans la pratique quotidienne et d’engager une réflexion individuelle par rapport à ces savoirs.
» (Rosenkranz-Fallegger 2009:44, notre traduction) Rosenkranz-Fallegger (2009) distingue les quatre dimensions suivantes par rapport aux compétences genre :
2. Compétences méthodologiques : elles désignent la capacité à transposer les savoirs touchant au genre dans différents contextes. Pour vous en tant qu’enseignant-e, cela comprend la capacité à intégrer les savoirs touchant au genre dans les contenus de votre discipline (cf. la dimension « contenus enseignés »), ainsi que par rapport aux dispositifs d’enseignement/ d’apprentissage (cf. la dimension « méthodes d’enseignement/ d’apprentissage »). Cette mise en œuvre dépend de la discipline et du contexte spécifique. 3. Compétences sociales ou relationnelles : ells se réfèrent à la gestion des rapports professionnels dans une perspective de sensibilité au genre: la faculté d’aborder et de transformer des discriminations, ainsi que la faculté de gérer la dynamique de groupe dans une perspective genre. En tant qu’enseignant-e, cela vous renvoie à la communication avec vos étudiant-e-s (cf. la dimension « communication par l’enseignant-e ») ainsi qu’aux interactions entre étudiant-e-s dans vos enseignements (cf. la dimension « interactions dans l’enseignement »). 4. Compétences réflexives : elles comprennent l’aptitude à mener une autoréflexion par rapport à son identité de genre ainsi que par rapport à ses propres représentations et manières d’agir à l’égard des hommes et des femmes. Cela nécessite une réflexion personnelle et une certaine capacité d’apprentissage. Cet aspect vous renvoie à la perception de soi en tant qu’enseignant ou enseignante (cf. la dimension « la personne de l’enseignant-e »). Remarque : Dans le contexte francophone, l’on fait en général la distinction entre les compétences disciplinaires et les compétences transversales. Nous avons préféré faire référence au concept utilisé dans le contexte germanophone, car il nous semblait plus précis. » Bibliographie | |
Contenus enseignés – Intégrer la dimension de genreVoici des exemples des questions que vous pouvez poser pour sensibiliser vos étudiant-e-s à la dimension de genre dans différentes disciplines :
| |
Contenus enseignés – Ressources pour aller plus loinPour prendre connaissance des thématiques traitées par les études genre : En langue allemande, le manuel des études genre dirigé par Becker & Kortendiek (2010) donne un aperçu très complet des approches et débats théoriques des études genre ainsi que de l’état de la recherche dans différents domaines thématiques. Plus récemment, le manuel de recherche interdisciplinaire sur le genre propose un vaste aperçu des débats et dresse l'état des lieux des études genre en relevant notamment les développements disciplinaires et internationaux (Kortendiek et al. 2019). | |
Culture disciplinaireLe terme de culture disciplinaire désigne les normes, les références et les codes qui se sont établis dans une discipline au cours de son histoire et qui sous-tendent les pratiques des membres de la communauté disciplinaire. Les codes de la culture disciplinaire se rapportent autant aux contenus et aux aspects méthodologiques qu’aux pratiques communicatives dans la discipline. C’est à travers l’apprentissage et l’incorporation des différents aspects de la culture disciplinaire par les étudiant-e-s que se forme leur identité disciplinaire. | |
D |
|---|
Déséquilibres dans les discussionsDans les échanges et les discussions, des déséquilibres peuvent se manifester par rapport à la participation des étudiantes et des étudiants ou par rapport à la dynamique des interactions. Voici une liste de questions qui peuvent vous aider à déceler ces déséquilibres:
» Bibliographie | |
DiversitéDe manière générale, le terme de « diversité » fait référence à la variété et la pluralité. Cependant, les références du terme varient selon les disciplines et les contextes. Diversité au sein du groupe des femmes / des hommes : De fait, les groupes des hommes et des femmes sont plus marqués par la diversité que par l’homogénéité. Vouloir repérer systématiquement des différences empiriques entre les hommes et les femmes quant à leurs qualités ou comportements pose un problème, car ce faisant, l’on présuppose ces deux catégories et l’on mesure les effets de la socialisation et des stéréotypes de genre. Il est reconnu que les différences au sein de chaque groupe sont plus grandes que la différence entre les moyennes de chaque groupe. Diversité résultant du lien entre le genre et d’autres dimensions : Au sein des études genre, il est aujourd’hui largement reconnu que la situation et les expériences des femmes et des hommes ne sont pas définies uniquement par la dimension de genre. L’approche intersectionnelle analyse les articulations entre la dimension de genre et d’autres dimensions d’inégalité sociale – notamment la classe sociale, la race (en tant que rapport social), l’origine culturelle ou l’orientation sexuelle – et mène une réflexion théorique à ce propos. Diversité résultant du décloisonnement des catégories de genre : La remise en cause de la binarité de la dimension de genre a débouché sur un décloisonnement des catégories de sexe et de genre. Les positions LGBTI manifestent la diversité des identités de genre et des orientations sexuelles dans la société. Diversité en pédagogie : Dans le contexte pédagogique, c'est plutôt le terme d'« hétérogénéité » qui est couramment utilisé. Il englobe tout l’éventail des différences parmi les élèves ou étudiant-e-s qui peuvent intervenir en situation d’enseignement/ d’apprentissage. Cela recouvre autant les différences linguistiques que les différences par rapport aux connaissances ou expériences préalables, autant les styles et rythmes d’apprentissage que les intérêts ou motivations différentes. Dans le cadre de l’enseignement supérieur, il s’agit donc de garder à l’esprit la diversité au sein du corps estudiantin. Bagage familial, motivations et intérêts d’une étudiante issue de milieu académique seront différents que ceux d’une étudiante ou d’un étudiant issu de milieu défavorisé. De même, bagage familial, motivations et intérêts d’un étudiant de milieu ouvrier suisse se distingueront de ceux d’une étudiante issue de l’immigration. En prenant en compte la diversité des étudiant-e-s dans votre enseignement, vous contribuez à réduire les stéréotypes de genre et à déconstruire une vision homogène des femmes et des hommes. Pour prendre en compte genre et diversité dans l'enseignement supérieur, cf. Eckmann & Földhazi (2013) ainsi que Czollek & Perko (2008). Au niveau institutionnel, la prise en compte de la diversité autant des étudiant-e-s que des collaborateurs et collaboratrices demande des stratégies de gestion de la diversité. | |
Doing genderComment les inégalités de genre se reproduisent-elles au quotidien ? Le concept du « Doing gender » s’avère être utile à cette réflexion, car il éclaire les processus (inconscients) de construction du genre dans les interactions et les pratiques quotidiennes. En effet, dans nos interactions quotidiennes, nous classons continuellement et sans y penser les personnes avec lesquelles nous sommes en contact soit dans la catégorie « hommes » soit dans la catégorie « femmes »; en même temps, nous affichons également notre propre catégorie en tant que femme ou en tant qu’homme ce qui, en règle générale, est perçu et validé par notre vis-à-vis. Pour réaliser à quel point ce mécanisme relève de l’évidence, il suffit de penser à l’embarras qui surgit dans une situation où la classification est ambiguë, par exemple si l’apparence d’une personne ne correspond pas à son registre de voix. | |
E |
|---|
Espaces éducatifs non-mixtesDans des disciplines fortement masculines, il peut être opportun de proposer ponctuellement des dispositifs d’apprentissage non-mixte, à l’école par exemple en physique. Cela permet aux garçons et aux filles d’expérimenter et de développer un éventail de comportements et d’intérêts plus large. Un tel dispositif permet notamment aux filles de développer des compétences et de l’assurance dans un domaine connoté comme étant masculin. | |
G |
|---|
GenreLe concept | |
Gestion de la diversitéDe plus en plus
souvent, les organisations du monde du travail – institutions de formation,
entreprises, etc. – mettent sur pied des stratégies de gestion de la diversité
de leur personnel ou des étudiant-e-s.
La
gestion de la diversité vise, d’une part, la reconnaissance des différences au sein du personnel ou du corps estudiantin – différence d’origine, d’expérience, d’âge, etc. – et plus particulièrement la mise à profit
de ce potentiel. Notamment dans les entreprises, mais aussi dans la recherche scientifique, l’on souligne la plus-value qui résulte de la diversité des perspectives et de l’expérience au sein d’une organisation ou d’une équipe.
D’autre part, la gestion de la diversité vise à garantir l’égalité des chances des étudiants et étudiantes ou des collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’à lutter contre toute forme de discrimination au sein de l’organisation. À côté de la dimension de genre, d’autres dimensions d’inégalité sociale sont prises en compte, notamment l’origine sociale et culturelle, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge. L’objectif de la gestion de la diversité est donc de protéger les personnes de préjudice ou de discrimination sur la base de ces marques distinctives et de garantir l’égalité des chances et de fait. Au cours de ces dernières années, les hautes écoles suisses ont élargi leur politique de l’égalité entre femmes et hommes à la gestion de la diversité. | |
I |
|---|
Interactions entre enseignant-e et étudiant-e-sParmi les facteurs qui peuvent expliquer des différences de motivation entre garçons et filles, Meece et al. (2006) discutent les schémas d’interaction entre enseigant-e et élèves en milieu scolaire. En général, les enseignant-e-s auraient tendance à apporter plus de soutien aux élèves envers qui leurs attentes sont élevées. Ces élèves auraient, de ce fait, plus souvent l’opportunité de montrer leur savoir et recevraient plus de retours encourageants. | |
Interactions entre enseignant-e et étudiant-e-s : ObservationLes questions suivantes peuvent vous aider à vous rendre compte de la manière dont vous gérez l’espace des interactions avec vos étudiant-e-s dans votre enseignement:
| |
IntersectionnalitéLe concept d’« intersectionnalité » prend en compte les différentes dimensions d’inégalité sociale dans leur articulation et leur interdépendance (cf. Walgenbach 2012). Sont pris en considération notamment la dimension de genre, la classe sociale, la race en tant que rapport social, l’origine culturelle, la sexualité, le handicap et d’autres. Le choix des dimensions pertinentes dépend de la situation spécifique et du contexte respectif. Dès leurs débuts, les études genre ont été préoccupées par la question de comment concevoir – au niveau théorique – l’articulation des rapports de genre avec d’autres rapports de pouvoir, notamment ceux de classe. Dans les années 1980, la critique de femmes noires, lesbiennes ou issues de l’immigration – pour ne mentionner que celles-ci – a attiré l’attention sur le fait que les théories et revendications féministes étaient développées à partir de la position de femmes blanches, hétérosexuelles, de classe moyenne et reflétaient leurs expériences sans prendre en compte l’expérience d’« autres » femmes. Une perspective intersectionnelle sur le système de formation révèle l’effet croisé de l’origine sociale, du genre et du pays d'origine sur les parcours de formation et l’accès à la formation supérieure. Une telle perspective peut également aider à mieux comprendre les situations concrètes d’enseignement et d’apprentissage. Un exemple : le rapport de genre qui sous-tend les interactions entre une enseignante de culture française et un étudiant de culture maghrébine sera modulé par l'origine culturelle respective des deux personnes. Ou encore : les étudiants d’origine européenne et issus de milieu académique prendront plus souvent la parole et auront plus de poids dans une discussion que des étudiant-e-s issu-e-s de milieux moins favorisés ou de culture extra-européenne. Enfin : si des étudiantes d'origine asiatique ne participent pas activement aux activités proposées, cela peu relever autant des méthodes d'apprentissage pratiquées dans le système éducatif de leur pays d'origine que de stéréotypes de genre.
| |
L |
|---|
Langage inclusif – anglaisPeut-être que vous dispensez également des enseignements en langue anglaise. La problématique d’un usage inclusif du langage se pose aussi en anglais. Même si les substantifs n’ont pas de genre grammatical, vous faites référence à une femme ou à un homme avec le pronom utilisé dans la phrase suivante. Un exemple : The director was invited to present the new project. She was accompanied by her assistant.
D’autre part, l’usage de « man » est souvent problématique. Voici des alternatives possibles :
Pour exprimer la diversité de genre (cf. LGBTI - identités « queer ») à travers le langage également, le pronom they s’est imposé en anglais comme troisième pronom au singulier à côté de he ou she :
Vous trouverez d’autres exemples et de plus amples informations sur le site des Nations Unies « Gender-inclusive language » : https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml | |
Langage inclusif – DéfinitionLe langage inclusif et un langage qui représente autant les femmes que les hommes et s’adresse ainsi bien aux unes qu'aux autres. Plus récemment, ce terme s'est imposé pour rendre compte de la diversité des identités de genre dans le langage également (cf. LGBTI - « identités queer »). On utilise également le terme de langage épicène. | |
Langage inclusif – Entrée en matièreDiverses études montrent que l’usage du générique masculin n’est pas perçu de manière neutre – en dépit du fait que ce soit son intention –, et qu’il renvoie davantage à des représentations mentales ayant trait aux hommes uniquement (Brauer & Landry 2008, Gygax et al. 2008, Gygax et al. 2021). | |
Langage inclusif – PrincipesVoici quelques principes de l’utilisation du langage inclusif :
Vous trouverez ici des ressources pour approfondir la thématique et pour en savoir plus sur l’usage du langage inclusif. | |
Langage inclusif – RessourcesIl existe différents guides d’utilisation du langage inclusif et, de manière plus large, de communication inclusive. Plusieurs hautes écoles entretiennent des pages web à ce sujet. Voici quelques ressources pour aller plus loin : L'Université de Fribourg recommande l'utilisation du langage inclusif et propose des outils pratiques sur le site du Service égalité, diversité et inclusion : https://www.unifr.ch/egalite/fr/actions/langage-inclusif L’Université de Neuchâtel entretient un site très complet « Langage en tous genres » qui éclaire la dimension historique de la thématique, présente des résultats actuels de recherche et propose des informations pratiques : https://www.unine.ch/epicene/ L'École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL a élaboré un site avec l'appui scientifique du Dr Pascal Gygax de l'Université de Fribourg. Vous y trouverez un guide pratique ainsi que des capsules vidéo pour approfondir vos connaissances du langage inclusif: https://www.epfl.ch/about/equality/fr/langage-inclusif/ Enfin, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO entretient un site à ce sujet : https://www.hes-so.ch/la-hes-so/egalite-et-diversite/hes-so-inclusive/ecriture-inclusive | |
LGBTI - identités « queer »Le sigle LGBTI recouvre différentes identités « queer » qui remettent en cause la binarité du genre et les logiques univoques de classement. La structure binaire du genre est intimement liée à la norme de l’hétérosexualité. C’est à travers les études gaies et lesbienne que, dès les années 1970, cette norme a fait l’objet de recherche et de débat dans le champ académique. Dès les années 1990, la thématique est reprise et développée dans le cadre des « Queer Studies », notamment aux USA. La philosophe Judith Butler a profondément marqué ce débat avec son œuvre « Gender Trouble » (1990) dont la traduction française a été publiée en 2005 seulement. Pour un historique détaillé, cf. le premier chapitre de Bereni et al. (2012). | |
M |
|---|
Masculin génériqueOn appelle « masculin générique » (ou masculin universel) l’usage de la forme grammaticale masculine pour désigner aussi bien des femmes que des hommes. Par exemple :
| |
Mixité dans l’éducationL’introduction de la mixité dans l’enseignement secondaire supérieur a principalement été envisagée dans une perspective de progrès social et de démocratisation de l’enseignement. Néanmoins, dans les pays anglo-saxons et germanophones à partir des années 1980, des voix critiques se sont fait entendre sur les effets négatifs de la mixité à l’école : en effet, la mixité ne menait pas nécessairement à l’égalité des chances pour les garçons et les filles (Burgess 1990). Ce débat n’a atteint la France que beaucoup plus tard (Delley 1998, Mosconi 2004).
La mixité dans le domaine de l’éducation n'en est cependant pas remise en cause pour autant. On estime toutefois que des stratégies doivent être mises en œuvre afin de parer aux effets négatifs de la mixité et de réaliser l’égalité entre filles et garçons dans le domaine de la formation. L'une d'elles consiste à mener ouvertement une réflexion autour de la mixité, tandis que l'autre revient à proposer ponctuellement des espaces éducatifs non-mixtes. » Bibliographie | |
P |
|---|
Participation des étudiant-e-sIl est largement reconnu en sciences de l’éducation que la participation active des étudiant-e-s favorise les processus d’apprentissage.
Comment inciter à la participation ?
« Think - Pair - Share » est un outil idéal pour susciter la participation de vos étudiant-e-s : https://teachingtools.uzh.ch/en/tools/think-pair-share | |
R |
|---|
Réflexion autour de la mixitéSi la mixité n’est pas remise en cause, il s’agit cependant d’engager une réflexion autour des pratiques d’enseignement et d’apprentissage dans les espaces éducatifs mixtes dans une perspective de sensibilité au genre. Les recherches touchant aux questions de la mixité en éducation se rapportent essentiellement à l’école, les questionnements soulevés sont toutefois pertinents pour les hautes écoles également : Comment créer des espaces éducatifs qui soient aussi favorable aux filles qu’aux garçons ? Comment réduire les comportements stéréotypés des garçons et des filles ? En Suisse, une étude s’est penchée sur ces questions en analysant l’enseignement de la physique (Herzog et al. 1999). | |
S |
|---|
Ségrégation horizontaleLe terme de « ségrégation horizontale » fait référence à la répartition inégale des femmes et des hommes entre les différentes filières d’études et les différents domaines professionnels. En effet, les disciplines et les professions sont souvent « genrées », c'est-à-dire associées à un univers soit masculin, soit féminin et considérées comme inappropriées pour l'autre groupe. | |
Ségrégation verticaleLe phénomène est récurrent : plus les positions sont élevées dans la hiérarchie d’une organisation, moins les femmes y sont présentes. Cela vaut pour le domaine de la formation autant que pour le monde des entreprises ou de la politique. On appelle « ségrégation verticale » cette répartition inégale des femmes et des hommes sur les différents échelons de la hiérarchie. La ségrégation verticale traduit l’inégalité d’accès des femmes aux carrières et au pouvoir de décision. Le terme de « plafond de verre » fait référence à la difficulté des femmes à accéder au plus haut niveau décisionnel (cf. Fassa et al. 2008, Fassa & Kradolfer 2010). | |
Sensibilité au genre dans l’enseignementDans le cadre de la mise en œuvre de l’égalité des chances entre femmes et hommes dans les institutions de formation le terme de « sensibilité au genre » dans l’enseignement s’est imposé ces dernières années. Un enseignement sensible au genre a pour objectif de permettre à chacun et chacune – indépendamment du fait d’être femme ou homme – de participer avec succès aux processus d’apprentissage ainsi que d’acquérir des certificats de formation. Actuellement, c’est par rapport au choix d’orientation (cf. ségrégation horizontale) ainsi que par rapport aux perspectives de carrières (cf. ségrégation verticale) que des inégalités persistent entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation supérieure. | |
Stéréotypes de genre - Analyse iconographiqueL’analyse iconographique d’un support visuel se prête bien à la sensibilisation de vos étudiant-e-s à d’éventuels stéréotypes de genre. Pour ce faire, voici quelques suggestions.
Choisissez un support visuel touchant à votre discipline, par exemple la page web de votre discipline, les brochures présentant votre filière d'études aux futur-e-s étudiant-e-s ou encore la page web d’une entreprise pertinente pour votre domaine d'enseignement. Pour analyser le support visuel choisi, la grille de questions suivante peut servir d’outil à vos étudiant-e-s:
| |
Stéréotypes de genre – DéfinitionLes stéréotypes de genre sont des représentations culturelles typées sur les femmes et les hommes. Ils présupposent une homogénéité interne au groupe des femmes et à celui des hommes. Ceci ne correspond manifestement pas à la réalité. Les stéréotypes de genre comprennent :
Des stéréotypes communs sont par exemple l’émotionnalité attribuée aux femmes et la rationalité attribuée aux hommes. Des fonctions hautement valorisées par la culture occidentale, telle que l’objectivité ou l’expertise, se déclinent de ce fait au masculin. » Stéréotypes de genre - Effets » Stéréotypes de genre - Analyse iconographique » Bibliographie | |
Stéréotypes de genre – EffetsAu quotidien, les stéréotypes se greffent imperceptiblement sur le sexe (masculin ou féminin) attribué à une personne. Il en découle des attentes spécifiques sur la manière dont la personne va se comporter. Les stéréotypes ont donc un impact sur la perception que nous avons d’une personne, le jugement que nous allons porter sur elle et l’évaluation de ses performances. | |
T |
|---|
Travaux de groupeDans l’enseignement supérieur, on a aujourd’hui souvent recours aux travaux de groupes et à des activités d’apprentissage collaboratives. La participation active des étudiant-e-s et les échanges au sein du groupe favorisent non seulement l’apprentissage, à cette occasion les étudiant-e-s acquièrent également des compétences sociales en vue du travail en équipe.
Si vous voulez aborder explicitement avec vos étudiant-e-s les questions de genre qui se posent par rapport au partage des tâches et des rôles dans les groupes de travail, vous avez la possibilité de varier la composition des groupes selon le sexe en fonction de vos objectifs pédagogiques. En effet, au sein d’un groupe non-mixte le partage des tâches et des rôles ne peut plus se reproduire selon une logique stéréotypée. Cela facilite la diversification des rôles et permet à chacun-e d’élargir son répertoire de compétences. Une telle intervention doit cependant être accompagnée d’une réflexion explicite. Les étudiant-e-s voudront savoir pourquoi vous leur demandez de former des groupes non-mixtes. Vous pouvez leur proposer de varier les dispositifs et leur donner des directives pour observer les interactions, le partage des tâches et leur expérience d’apprentissage dans les différents contextes de travail. Ces observations pourront ensuite faire l’objet d’une mise en commun et d’une discussion. Vous pouvez aussi faire référence au débat controversé autour de la mixité dans l’éducation et en discuter les avantages et les inconvénients. » Bibliographie | |